"Asphalte ou Karabé de Sodome, Asphaltus, c’est le nom que l’on donne au bitume de Judée, parce qu’on le tire du lac Asphaltide"
Ainsi débute l’article "Asphalte" du Dictionnaire Raisonné Universel d’Histoire Naturelle de Valmont-Bomare (1791). Pour être plus précis, l’auteur ajoute que c’est une substance qui "s’élève du fond des eaux sur la surface du lac Asphaltite ou Mer de Loth, ou mer morte (lieu où étaient autrefois les deux villes criminelles qui furent englouties, Sodome et Gomorrhe)". Ce "bitume" surnage à la surface du lac. Dans un premier temps, nous dit l’auteur, "il est mou, très visqueux, très tenace, mais il s’épaissit avec le temps et acquiert plus de dureté que la poix sèche". Les Arabes, voisins du Lac, s’en serviraient pour goudronner leurs bateaux. De vieilles traditions lui attribuent bien d’autres usages :
"On prétend que ce bitume entre dans la composition des beaux vernis noirs de l’Inde et dans celle des feux d’artifice que les orientaux font brûler sur l’eau. Selon le témoignage des anciens, les murs de Babylone furent cimentés avec l’asphalte. Ce bitume de Judée qui est un élément de la grande thériarque (remède universel) est quelquefois nommé gomme de funéraille et de momie, parce que le commun du peuple, chez les Egyptiens, en faisaient usage autrefois pour embaumer les corps morts de leurs parents, et même les oiseaux sacrés".
Mais l’asphalte qui intéresse d’abord les lecteurs français de l’article du Dictionnaire de Valmont-Bomare, est celui que l’on trouve dans le sous-sol de Neufchâtel, en Suisse, et qui s’exploite en galeries.
En date du 21 février 1720, un arrêt du "Conseil d’Etat du Roy Louis XV", autorise le Sieur de la Sablonnière, Trésorier des Ligues Suisses, à faire " entrer dans le Royaume, de la Mine de Pierre d’Asphalte préparée et non préparée, et l’Huile qui se tire de cette Pierre ". Et ceci sans aucune taxe. C’est dire l’importance accordée au produit par le pouvoir royal. Il servira en 1743 à rendre étanches les bassins de Versailles et à y réparer un certain nombre d’ouvrages.

Bassin d’Apollon à Versailles.
Deux vaisseaux partant pour Pondichéry et le Bengale seront carénés avec cet asphalte qui se montre efficace pour lutter contre les tarets, ces "vers" qui infestent les mers chaudes et dont les galeries détruisent les coques des navires.

Navires de la Compagnie des Indes à Pondichéry.
La mine de Neuchâtel se visite encore aujourd’hui et le touriste peut même y déguster un traditionnel " jambon cuit dans l’asphalte "

Le cuisinier à l’asphalte.
.
Elles se trouvent en Alsace et ont également été ouvertes par Louis Pierre Ancillon de La Sablonnière. Il existe dans ce pays, nous dit Valmont-Bomare, "une fontaine dont l’eau, quoique claire et limpide, sent un peu le goudron, à cause des parties bitumineuses dont elle est chargée. Les habitants du pays estiment singulièrement cette eau pour tenir le ventre libre et exciter l’appétit : les bains de cette fontaine sont aussi très salutaires pour les maladies de la peau". Ces eaux sur lesquelles surnagent en permanence "un bitume noir et une huile rouge" auraient fait donner à cette fontaine le nom de Backelbrunn ou fontaine de poix.
Nous retrouverons cette fontaine sous le nom transformé de Pechelbronn. Cette fontaine a jailli quand des fouilles ont été faites dans l’espoir de trouver dans le sous-sol des métaux précieux. On y a trouvé de l’asphalte mais aussi du charbon et bientôt un liquide qui fera la fortune des exploitants : le pétrole. Nous en reparlerons.
Pour ce qui est de l’asphalte, son nom, pour nos contemporains est généralement lié au revêtement des routes. La technique a pris son essor au milieu du 19ème siècle.
Un article de la revue La Nature, daté de 1881, nous détaille le travail de l’asphalte. L’auteur, ingénieur, conférencier au Conservatoire des Arts et Métiers, rappelle que sous le nom général de bitume on a désigné un liquide épais, parfois pur, mais souvent mélangé à des terres diverses. La tradition a conservé le nom d’asphalte pour un bitume particulier constitué d’une roche calcaire aux pores imprégnés de bitume. Son intérêt, découvert par des entrepreneurs en travaux publics à partir des années 1850, consiste en sa capacité à être compacté.
Il se raconte que cette propriété aurait été observée par hasard dans une mine d’asphalte : les morceaux tombés sur le sol et écrasés sous les roues des charrettes auraient fini par constituer une voie très résistante. Un ingénieur suisse aurait été le premier à utiliser le procédé pour asphalter une route. En France, Henry Darcy, ingénieur général des Ponts et Chaussées le recommandait, en 1850, pour la voirie de Paris. Le premier essai était fait en 1854, rue Bergère, à Paris.

Coulage d’asphalte sur un trottoir à Paris Revue La nature, 1881
Inévitablement, la nouvelle technique devait opposer partisans et adversaires. L’asphalte serait glissant pour les chevaux les jours de pluie. Il serait cassant en hiver et deviendrait liquide en été. Un ingénieur civil, Léon Malo, avait alors l’idée de le couler avec des graviers pour donner un revêtement solide et commode qui remplacerait peu à peu les pavés quand la voiture automobile viendrait prendre la place des fiacres et des chevaux. Chacun connaît le succès ultérieur de la méthode.
L’asphalte était donc un matériau précieux mais plusieurs des régions d’où il était extrait produisaient également un produit dont l’intérêt allait bientôt dominer : le pétrole.
Pétrole, Petroleum, huile de pierre : "c’est un bitume liquide, inflammable, d’une odeur forte, d’une saveur pénétrante, très amère et exhalant dans le feu une vapeur fétide ; il surnage toutes les liqueurs. Cette huile minérale découle le long de certains rochers, à travers des terres et des pierres dans la Sicile, dans l’Italie, en France, en Allemagne, etc.".
Un "bitume liquide" : cette introduction de l’article Pétrole du Dictionnaire de Valmont-Bomare (1790) est caractéristique de la hiérarchie des intérêts accordés au pétrole à la fin du 18ème siècle. Nous avons déjà noté que le bitume (ou asphalte) de Neufchâtel, en Suisse, a rendu étanches les bassins de Versailles. L’huile de pétrole est également connue depuis des siècles, essentiellement sous forme d’un remède médical. La plus célèbre, en France, est l’huile de Gabian.
Gabian est une commune de l’Hérault. On fait remonter aux premiers siècles de notre ère la mise à jour, par les romains, d’une source de cette "huile de pierre" semblable à celle que leurs médecins utilisaient déjà pour soigner de l’arthrose et de diverses maladies de la peau. Avec des fortunes diverses, la tradition avait traversé les siècles. En 1752 paraissait à Bézier un "Mémoire sur l’huile de Pétrole en général et particulièrement sur celle de Gabian". Lu à l’Académie des Sciences et Belles Lettres de Béziers, approuvé par l’Université de Médecine de Montpellier, il avait été publié sous l’autorité de l’évêque et seigneur de Bézier qui entendait bien tirer bénéfice de cette source. En effet, nous disait l’auteur du mémoire, une rumeur avait couru qui affirmait que cette source était abandonnée, il convenait donc "d’informer le public que ce baume minéral coule depuis quelque temps avec assez d’abondance pour en fournir, non seulement à tout le royaume, mais encore aux pays étrangers, par les dépenses qu’a faites M. De Bosset de Roquefort, Evêque de Béziers, Seigneur de Gabian, pour remettre cette Fontaine en état".
Et pour éviter toute falsification il était ajouté que le prélat avait pris des précautions qui consistaient "à faire recueillir cette Huile par une personne de qualité éprouvée qui a ordre de la mettre dans des bouteilles de différentes grandeurs, de sceller ces bouteilles du Sceau de ses Armes et de signer l’étiquette qu’on y met dessus ; de sorte qu’à présent on est assuré d’avoir, quand on veut, de l’Huile de Pétrole toute pure et telle qu’elle coule naturellement de la source".
Excellente publicité. De telles précautions suggéraient, à elles seules, que le précieux élixir possédait de fabuleuses propriétés.
Le texte reprenait un Mémoire publié en 1717 par M. Rivière, médecin et membre de la Société Royale des Sciences de Montpellier. Le Grec Dioscoride (40-90), l’un des pères reconnus de la pharmacologie était d’entrée mis à contribution. Le Naphte (terme d’origine grecque pour désigner le bitume), affirmait-il "est très efficace contre les vapeurs de Mères et contre les relâchements de l’utérus, soit en parfum soit en liniment. Cette huile prise avec du vin et du castoreum (sécrétion produite par les glandes sexuelles du castor) provoque les Mois aux femmes. Elle est d’un grand secours dans les vieilles toux et dans les difficultés de respirer. Elle remédie aux morsures de serpent, aux douleurs de sciatique et aux points de côté. Prise en bol elle apaise des maux d’estomac et avalée dans du vinaigre elle dissout le sang caillé ; Délayée dans de l’eau d’orge et prise en lavement elle guérit la dysenterie. En parfum elle soulage ceux qui sont enrhumés et appliquées sur les dents elle apaise la douleur. Enfin si on l’applique avec de la farine de la cire et du nitre elle est merveilleuse contre la léthargie et les douleurs de goutte et de sciatique".
Et si ce n’était pas encore assez, l’auteur ajoute que Pline (23-79) lui attribue aussi la propriété de "guérir la lèpre, les dartres et les démangeaisons, d’arrêter le sang, de réunir les plaies et de les consolider".
Avec une telle introduction, digne des meilleurs bateleurs de foires, le succès était assuré.
Mais les auteurs du 18ème siècle n’ignorent pas, non plus, que dans certains pays lointains l’huile de pétrole sert à un usage bien plus matériel. "Ce bitume liquide, nous dit Valmont-Bomare, sert à éclairer en Perse et plusieurs autres lieux, mais notamment à Bakou, ville située sur la mer Caspienne, à trois milles d’Astracan, où il n’y a point de bois. On y fait un commerce si considérable de pétrole, qui s’y puise dans plus de vingt puits, que le souverain, c’est-à-dire le Khan de Bakou, en retire annuellement de droit régalien 40 000 roubles, ce qui fait environ 200 000 livres argent de France". Déjà un Prince du Pétrole et des pétroroubles avant les pétrodollars.
Quel usage pour ce pétrole ? "On le brûle dans les temples et les maisons , dans des lampes garnies de mèches grosses comme le pouce. Quelques voyageurs assurent qu’on brûle plus de cette huile minérale que de chandelles à Bagdad. On s’en sert aussi au lieu de bois : pour cet effet on jette deux ou trois poignées de terre dans l’âtre de la cheminée, on verse ensuite l’huile minérale par-dessus, puis on allume avec un bouchon de paille, et sur-le-champ il en résulte une flamme assez vive ; plus on agite et retourne la terre imbibée et mieux elle brûle : il en sort une vapeur bleuâtre, d’une odeur plus ou moins disgracieuse et la fumée noircit entièrement les habitations ; cependant on prétend que les aliments n’en contractent absolument aucun mauvais goût".
N’oublions pas non plus que nous sommes en Perse et que les vieux cultes du feu n’y sont pas encore éteints : "Les Gaures (mot d’origine arabe signifiant infidèle, traduit également par Guèbres) et les Persans qui adorent le feu et qui suivent la religion de Zoroastre leur instituteur, viennent à Bakou pour rendre leur culte à Dieu qu’ils adorent sous l’emblème du feu ; la flamme du pétrole allumé est pour eux le feu éternel et le Soleil, le symbole le plus frappant de la Divinité".
Un siècle plus tard, le feu de Zarathushtra brûle à présent dans les plus banales lanternes et les temples du feu sont essentiellement visités par les touristes.
Un article de la revue La Nature, daté de 1884, nous décrit les derniers prêtres de Bakou :
 "Il n’existe plus guère de temple du feu et le plus célèbre sans doute de tous est celui d’Atech Gach, près de Bakou, sous la coupole duquel, l’autel est perpétuellement couvert de flammes. Il y a quelques années encore, ce temple était desservi par trois ou quatre prêtres, mais dernièrement il n’en restait plus qu’un, et, signe des temps, comme le nombre des paroissiens a diminué d’une façon extrêmement remarquable, puisqu’on ne voyait plus arriver par an que deux ou trois Parsis, ce brave pontife, au lieu d’exploiter la crédulité des adorateurs du feu, exploitait tout simplement les sources de pétrole de son temple, dont l’huile, paraît-il, était d’excellente qualité et qu’il vendait fort bien".
"Il n’existe plus guère de temple du feu et le plus célèbre sans doute de tous est celui d’Atech Gach, près de Bakou, sous la coupole duquel, l’autel est perpétuellement couvert de flammes. Il y a quelques années encore, ce temple était desservi par trois ou quatre prêtres, mais dernièrement il n’en restait plus qu’un, et, signe des temps, comme le nombre des paroissiens a diminué d’une façon extrêmement remarquable, puisqu’on ne voyait plus arriver par an que deux ou trois Parsis, ce brave pontife, au lieu d’exploiter la crédulité des adorateurs du feu, exploitait tout simplement les sources de pétrole de son temple, dont l’huile, paraît-il, était d’excellente qualité et qu’il vendait fort bien".
Excellente est, en effet l’huile de Bakou. Un rapport d’un consul anglais considère "que Bakou renferme beaucoup plus d’huile que les régions pétrolifères d’Amérique et que les sources de pétrole de Bakou sont sans pareille dans le monde entier". L’extraction en est commode. Alors qu’il est courant en Amérique de forer jusqu’à 2000 pieds ( environ 700m) pour trouver du pétrole, "au Caucase, au contraire, la profondeur des puits ne dépasse jamais 140mètres et il y en a beaucoup dont la profondeur est inférieure à 60 mètres ; dans certains endroits il suffit d’enfoncer une carne dans la terre pour en faire jaillir le gaz, et il n’est pas rare de trouver le pétrole en grande masse, à 5 mètres du sol".
En 1882, suivant l’estimation du consul britannique, Bakou avait produit trois millions d’hectolitres de pétrole. Une partie était distillée sur place. On en retirait environ une douzaine de produits classés en deux catégories. D’abord de 30% à 40% du produit roi, le Kérozine, pétrole lampant ou photogène. En effet, le pétrole est d’abord utilisé pour l’éclairage. Des deux tiers restants, considérés comme un "résidus", on extrayait quand même des paraffines, des vernis et surtout de l’huile et de la graisse lubrifiantes, forts utiles pour toutes les machines de ce siècle industriel. Noter aussi que les meilleures installations étaient capables de recueillir et condenser "l’essence de pétrole" constituée par les produits les plus volatils connus alors sous les noms de benzoline ou de gazoline et dont l’importance deviendra primordiale par la suite.
Ce pétrole de Bakou est d’un transport difficile mais il intéresse les frères Nobel qui créent pour l’exploiter, en 1879, la "Société pour l’exploitation du Naphte, Nobel frères". Elle est présente sur le stand de la Russie à l’exposition internationale de 1900 à Paris. A cette date les multiples puits exploités sont reliés à l’usine de raffinage mise au point par Alfred, le chimiste inventeur de la dynamite, par un réseau de tuyaux long de 304 kilomètres. Elle dispose de 189 bateaux-citernes et remorqueurs représentant un tonnage de 182 000 tonnes pour transporter le pétrole sur la Caspienne et de 1237 wagons pour l’acheminer jusqu’à la Mer Noire et différentes villes de Russie et de là vers l’Europe. Elle doit faire face cependant à un rude concurrent.
Aux Etats-Unis, plus encore qu’en Europe à la même époque, le pétrole est d’abord vendu comme un remède miracle : "l’huile de Seneca" qui emprunte son nom à une tribu Iroquois. Ceux-ci l’utilisaient comme médicament et pour des pratiques rituelles. La technique pour le recueillir avait d’ailleurs été empruntée aux autochtones. Ils creusaient des puits carrés, peu profonds et boisés à l’intérieur. Ils laissaient séjourner pendant quelque temps des couvertures de laine au fond de ces cavités, puis retiraient les couvertures pour les tordre. Les Américains conservèrent ce mode d’exploitation longtemps après avoir chassé les premiers occupants. L’huile était vendue en flacons par des colporteurs qui sont restés, dans le folklore américain, comme des figures traditionnelles de la conquête de l’Ouest.
Vers 1850 apparaissent en Europe les lampes à huile minérale. Les premières d’entre elles avaient été mises au point par un manufacturier de Paris, Alexandre Selligue, qui en avait déposé le brevet en 1838. Son combustible était alors un produit de la distillation de l’huile de schiste. L’huile de pétrole a rapidement pris le relai. Le produit étant bien moins onéreux que l’huile de baleine qui était alors le produit phare. Il allait rapidement inonder le marché. L’ère du pétrole roi commençait.

La lampe à pétrole, symbole du confort bourgeois du 19ème siècle (Illustration de Germinal).
En 1859 Edwin Laurentine Drake, dit "le colonel", recueillait du pétrole, à Titusville en Pennsylvanie, dans un forage d’une dizaine de mètres de profondeur. La technique était nouvelle en Amérique où le pétrole était généralement recueilli dans des écoulements de surface.
La nouvelle provoquait une véritable ruée vers l’or noir. Pierre Juhel, dans son "Histoire du Pétrole" (Vuibert, 2011), cite un journal local : "Une nuée d’aventuriers s’est abattue sur cette nouvelle terre promise et a entrepris des forages de tous côtés. Aucun placement, en effet, ne saurait être plus lucratif. Le centre de la région ainsi exploitée est Clintock à 12 milles de Titusville […] On ne voit de tous côtés que des charpentiers occupés à construire des huttes, des hangars et des granges qui ne tarderont pas à faire place à une ville florissante".
La "ferme de la veuve Mac Clintock" est restée célèbre dans la saga pétrolière. En 1863, une nappe jaillissante y donna 1000 barils d’huile par jour et dès l’année suivante la propriétaire du terrain percevait 2000 dollars de royalties par jour pour les puits présents sur sa terre. Cette femme avait conservé l’habitude d’attiser son feu de bois avec du pétrole, dangereuse méthode, elle en mourut brûlée. Son fils adoptif, John Steel, âgé de 20 ans héritait d’une fabuleuse fortune qu’il dilapida de façon extravagante. Ce qui lui valut d’entrer dans la légende sous le nom de "Coal oil Johnny", Jean du pétrole.
Après la Pennsylvanie, un nouvel eldorado allait naître en Californie. Dans les années 1880, la région de Los Angeles respirait le parfum des orangers et des citronniers. On y venait des régions froides du Nord Américain pour y passer des hivers ensoleillés, ce qui alimentait une spéculation immobilière. L’un de ces promoteurs avait vu trop grand et plusieurs des propriétés mises en vente se trouvèrent sans acquéreur. Les administrateurs de la société se souvinrent alors d’anciennes prospections qui avaient révélé des traces de pétrole dans le secteur.
Après plusieurs essais infructueux, vient la nuit du 15 au 16 juillet 1894. Une énorme explosion souterraine éveille les habitants qui croient avoir affaire à un tremblement de terre. Une véritable trombe de pétrole sort du puits, entrainant avec elle les déblais, les outils et même d’énormes blocs de pierre. L’odeur du pétrole remplace celle des orangers.

Puits jaillissant de pétrole. Louis Figuier, les Merveilles de la Science, 1870.
Après avoir tenté de faire boucher le puits, la municipalité de Los Angeles mesurait tout l’intérêt de la découverte. Bientôt l’entreprise de promotion immobilière se transformait en compagnie pétrolière, la Californian Oil Company, pendant qu’à la place des citronniers se dressait une forêt de derricks et d’éoliennes actionnant les pompes des puits. A la fin de l’année 1895, quatre cents compagnies différentes exerçaient leurs activités autour de Los Angeles. La Santa Fe Terminal Railroad avait poussé ses voies ferrées jusqu’au pied de chaque puits et arrosait tout le pays jusqu’aux ports qui transportaient le pétrole vers l’Europe. Des fortunes immenses se construisaient en très peu de temps et le pétrole méritait bien alors son nom "d’or noir".
Nous avons déjà rencontré les mines de Pechelbronn (ou Backelbrunn), en Alsace, exploitées depuis Louis XV pour son asphalte. Un article de la revue La Nature, de 1890, nous décrit un paysage bien modifié. Une pointe de nostalgie d’abord : on y signale que "Pechelbronn, dont le nom allemand signifie la Fontaine de la Poix, est une annexe de la commune de Merkweiler, dans notre ancien département du Bas-Rhin, au pied des Basses Vosges". La guerre de 1870 entre la France et la Prusse a déplacé les frontières. Celle qui se prépare déjà, et qui éclatera quatorze ans plus tard, aura également des liens avec le charbon et le pétrole.
Mais revenons au Pechelbronn de 1890. L’auteur de l’article nous invite à une visite guidée : "En regardant autours de vous, dans la localité, vous voyez du bitume noir, d’une consistance huileuse, surnager au-dessus des rigoles, à travers les prairies… Une villa, habitée par la famille Lebel, propriétaire des exploitations de pétrole, s’élève au bord de la route de Lampersloch à Soulz-sous-Forêt, entourée de raffineries d’huile minérale, avec leurs grandes cheminées fumeuses. Dans la prairie, pointent de distance en distance des pyramides en Planche, pareilles à des flèches de clocher sans tour, mais contre lesquelles s’adossent de petites maisonnettes en planche également. Ce sont les abris des sondages pour la recherche du pétrole jaillissant".

Puits de Pétrole à Pechelbronn, d’après une photographie. La Nature, 1890.
Dans le paysage se trouvent aussi les installations pour la distillation du pétrole. Suivant la densité des produits obtenus, par rapport à l’eau, on distingue la gazoline (0,670), la benzine (0,690 à 0,700), le naphte (0,715), la ligroïne (0,725), le pétrole lampant (0,800 à 0,810), les huiles légères (jusqu’à 0,850) et les huiles lourdes (0,850 à 0,890) pour le graissage. En cette fin de 19ème siècle, les essences de pétrole, benzine et gazoline, sont considérées comme des déchets peu utiles. Trop volatils et trop inflammables, elles étaient trop dangereuses pour l’éclairage. Seule la célèbre et robuste lampe "pigeon" y était adaptée. Dix ans plus tard, ces "déchets" allaient révéler leur valeur marchande.

Publicité pour le pétrole de Pechelbronn. La Vie en Alsace, 1933.
Privé de l’Alsace, le gouvernement français encourageait alors la prospection sur d’autres secteurs du territoire. Avec le retour de la fièvre pétrolière dans notre France contemporaine, un coup d’œil rétrospectif sur les sites visités, ne manque pas d’intérêt.
Premier vieux souvenir, Gabian et son pétrole-médicament authentifié par le sceau de l’évêque de Béziers. Un sondage jusqu’à 413 mètres ne donne aucun résultat, sinon un peu de gaz.
Ensuite Grenoble, ou plutôt, à proximité, la commune de Saint-Barthélémy sur Gua où brûle la "fontaine ardente". Des émanations de méthane sortent pas des fissures du sol et s’enflamment, un indice prometteur. Hélas, après un sondage à 198 mètres le pétrole n’est toujours pas là. Aujourd’hui la fontaine ardente, qu’une publicité touristique considère comme l’une des 7 merveilles du Dauphiné, brûle encore et mérite la visite, même si certains amateurs regrettent un aménagement du site peu respectueux de l’environnement naturel.
Dans la Limagne d’Auvergne des indices également existent. Ici et là sourdent des sources de bitume. Le Puy de la Poix, volcan érodé qui possède une source régulièrement exploitée, mérite bien son nom. Elle suinte encore aujourd’hui et est remise en valeur par des défenseurs éclairés du patrimoine.
Ces sondages de 1893 ne connaissent pas le succès. Ce qui n’empêchera pas d’autres tentatives entre 1919 et 1922. En 1919, un forage près de la mine de bitume de Pont-du-Château déclenche un phénomène spectaculaire au moment où la sonde atteint 415 mètres. Sous la pression des gaz libérés, de véritables geysers sortent du tubage de la sonde. Dans une "Note sur les recherches de pétrole dans la Limagne", Philippe Glangeaud, professeur de géologie à l’université de Clermont-Ferrand, témoigne :
"Le 21 décembre, à minuit trente, alors que l’on remontait un taraud, se produisit une violente explosion qui réveilla tous les habitants de Martres-d’Artrières. Le geyser venait d’entrer de nouveau en activité et de projeter, hors du trou, 180 mètres de tiges qui traversèrent le toit de la tour et tombèrent dans le ruisseau voisin entrainant le taraud avec elles.
Le poids de ce projectile d’un nouveau genre atteignait 2500 kilogrammes et mesurait 180 mètres de long. C’est, je crois, un record de projection de geyser. Il n’y eut heureusement aucun accident humain". (La Nature, 1893)
Hélas de ce puits ne jaillira pas du pétrole mais "du sable et du bitume dans lequel s’enlisaient les visiteurs qui s’approchaient de trop près pour observer le phénomène". Après avoir éjecté plusieurs centaines de kilogrammes de bitume par jour, le forage ne donne bientôt plus que de l’eau chargée de gaz carbonique qu’une société, la Carbonique d’Aigueperse, entreprit d’exploiter. La Limagne ne verra donc pas se dresser des derricks sur son sol. Elle figure encore actuellement cependant sur la carte des zones vouées à la recherche de pétroles "non conventionnels".
Ayant perdu l’Alsace, la France fait donc piètre figure dans le domaine de la production pétrolière. C’est ce que révèle l’Exposition Universelle de 1889 à Paris.
L’exposition de 1889 à Paris, pour le centenaire de la révolution française, a été d’abord une vitrine pour le charbon, l’acier, la vapeur et l’électricité naissante. L’industrie pétrolière n’a cependant pas été oubliée. L’initiative de sa mise en scène est due à la famille Deutsch, industriels français spécialisés dans le raffinage du pétrole. Dans un vaste réservoir servant au stockage du pétrole était disposé un diaporama représentant l’industrie pétrolière dans le monde.
"A notre époque où la lumière est devenue pour tous un besoin impérieux et une condition de bien-être, il est fort intéressant de suivre dans sa production, ou plutôt dans son élaboration, le pétrole qui a su prendre rang et le conserver à côté du gaz et de l’électricité. C’est ce que nous montre le panorama". (LaNature, 1889). L’éclairage est donc bien, pour le moment, l’intérêt principal du pétrole.
A vrai dire, seules deux régions étaient représentées sur ce diaporama : les Etats-Unis et le Caucase. Mais comment se forme ce pétrole ?

Panorama du pétrole à l’Exposition Universelle de Paris en 1889. La Nature, 1889.
L’article de La Nature évoque la polémique du moment : "Le chimiste allemand Engler en fait remonter la production à la décomposition lente de végétaux et d’animaux antédiluviens ; Berthelot et Mendeleïev l’attribuent à des réactions chimiques résultant de phénomènes volcaniques".
Neptuniens d’un côté (décompositions d’organismes végétaux dans la mer), Plutoniens de l’autre (origine volcanique), le débat est d’importance.
Les producteurs américains alimentent une campagne de dénigrement à l’encontre des gisements de Bakou. Ils sont en cours d’épuisement, disent-ils. Mendeleïev, célèbre pour la mise au point du tableau périodique des éléments chimiques, est aussi directeur des mines du Caucase et réplique immédiatement : le Caucase est en mesure d’alimenter le monde entier pour tous les usages. D’ailleurs, affirme-t-il, les réserves de pétrole sont inépuisables. Sous l’écorce, la matière terrestre serait constituée de carbures métalliques, particulièrement de fer. A travers les failles de la croûte, de l’eau s’infiltrerait qui réagirait avec ces carbures en donnant des oxydes et des carbures d’hydrogène qui, en remontant vers la surface, se combineraient pour donner les différents composés du pétrole. Alors pas d’inquiétude, là où le pétrole sort il continuera à sortir.
Même si la thèse du pétrole issu de la fossilisation de matières organiques l’a emporté, des scientifiques défendent, encore aujourd’hui, la possibilité de pétrole "abiotique".
Indifférent à l’aspect théorique de la querelle, le rédacteur de l’article de la Nature semble, pour sa part, pencher pour le pétrole russe. Il aurait, sur les pétroles américains, l’avantage "de contenir de la benzine, de l’anthracène et de l’huile d’anthracène, c’est-à-dire les mêmes principes précieux que le goudron de houille, permettant d’obtenir la gamme prestigieuse des matières colorantes dont l’industrie des teintures fait actuellement un si grand usage. C’est pour le pétrole russe un appoint dont on ne saurait calculer les conséquences".
L’exposition se veut didactique. On y représente "les énormes canalisations de tuyaux ou pipe-lines qui, au Caucase et aux Etats-Unis surtout, s’étendent sur des longueurs étonnantes". Le plus long, celui de Philadelphie, fait, à lui seul, 372 kilomètres de longueur. Ces tuyaux alimentent des réservoirs de fer de 4500 à 6000 hectolitres de capacité, semblables à celui où se tient l’exposition.
Pour ce qui est de l’expédition, le temps est venu des bateaux-citernes (tank-steamers ou tank-ships) qui peuvent transporter jusqu’à 32 000 tonnes de pétrole. Ils remplacent peu à peu les antiques navires où le pétrole était contenu dans de petits tonneaux de bois, des "barils". Ce conditionnement en "barils" est issu des méthodes utilisées à Pechelbronn au 18ème siècle et importées aux USA. Le baril de 42 gallons américains, soit environ 159 litres, est resté la mesure internationale pour les transactions pétrolières.
Ces pétroliers d’un nouveau genre sont-ils plus sûrs ? On se souvient encore, au moment où se tient l’exposition, de l’explosion survenue dans le port de Calais le 16 octobre 1888.
Le pétrolier Ville-de-Calais est "un superbe navire jaugeant 1221 tonneaux, construit en acier et pourvu de puissantes machines, les quelles étaient placées tout-à-fait à l’arrière, de façon à ce que les chaudières fussent bien isolées de la partie du navire contenant le pétrole" (revue La Nature, 1888) . Pourtant, en ce jour néfaste, le pétrolier ayant livré son chargement se préparait à appareiller vers New-York puis Philadelphie quand le capitaine en second et le troisième mécanicien descendirent inspecter la cale. "Quelques instants après, une immense colonne de feu s’éleva à plus de 100 mètres et fut suivie d’une formidable détonation. On suppose que l’un de ces malheureux aura voulu enflammer une allumette qui aura mis le feu au gaz de pétrole resté dans l’un des compartiments.
Le choc produit a été tel que la plupart des rues de l’ancien Calais se sont trouvées jonchées d’éclat de vitres. A Saint-Pierre-lès-Calais, la secousse s’est faite tellement sentir, que dans plusieurs maisons les portes se sont ouvertes et que le gaz s’est éteint. Le bruit de l’explosion s’est étendu jusqu’à Boulogne et Douvres. Toutes les rues de calais ont été jonchées d’éclats de verre ; des plaques de tôle ont été arrachées au navire et projetées à plus de 500 mètres de distance. Le cadran de l’hôtel de ville s’est fendu".

L’explosion du Ville-de-Calais, La Nature, 1888.
Le bilan humain est de trois morts. Quant au bilan écologique, il n’est pas encore à l’ordre du jour. Il faudra attendre la fin du 20ème siècle et des accidents majeurs comme ceux de l’Amoco Cadiz ou de l’Erika pour qu’on commence vraiment à s’inquiéter des pollutions marines provoquées par les dégazages et les échouages.
Déjà, en 1889, se dessine un usage étendu du pétrole. D’abord l’éclairage domestique ou encore celui des phares. Ensuite le chauffage industriel, le graissage des machines, le traitement des laines cardées, la fabrication de tissus caoutchoutés, l’imperméabilisation des tissus, la teinture, la parfumerie, la photographie et même le traitement du phylloxera ou la lutte contre les invasions de criquets en Algérie.
Mais s’annonce un nouveau débouché : "le mélange d’air et d’essence ou gazoline, est employé dans des moteurs spéciaux, système Otto, Lenoir, Rouart, Benz, Salomon et Tenting, Panhard et Levassor, Diederich, Noël, Forest, etc., pour produire la force motrice. Le principe consiste à fabriquer, de toutes pièces, un gaz détonnant analogue au gaz d’éclairage et que l’on utilise à peu près de la même façon".
Il existait déjà des moteurs fonctionnant au gaz d’éclairage issu de la distillation de la houille, mais ils étaient nécessairement fixes. Avec les essences de pétrole et l’invention du carburateur, ces moteurs pouvaient équiper des automobiles. Bientôt l’essence de pétrole ne sera plus un déchet encombrant mais un produit de grande valeur.









/image%2F0561035%2F20230112%2Fob_0ae4c9_lampadaire-dublin.jpg)
































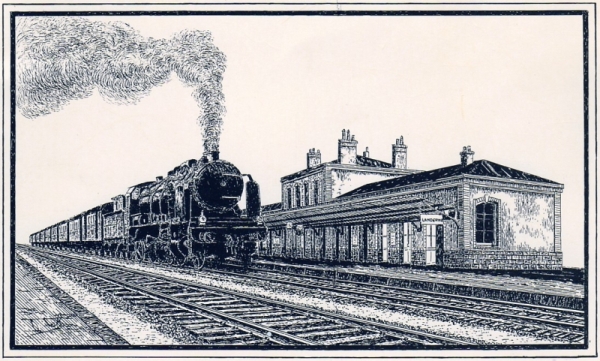


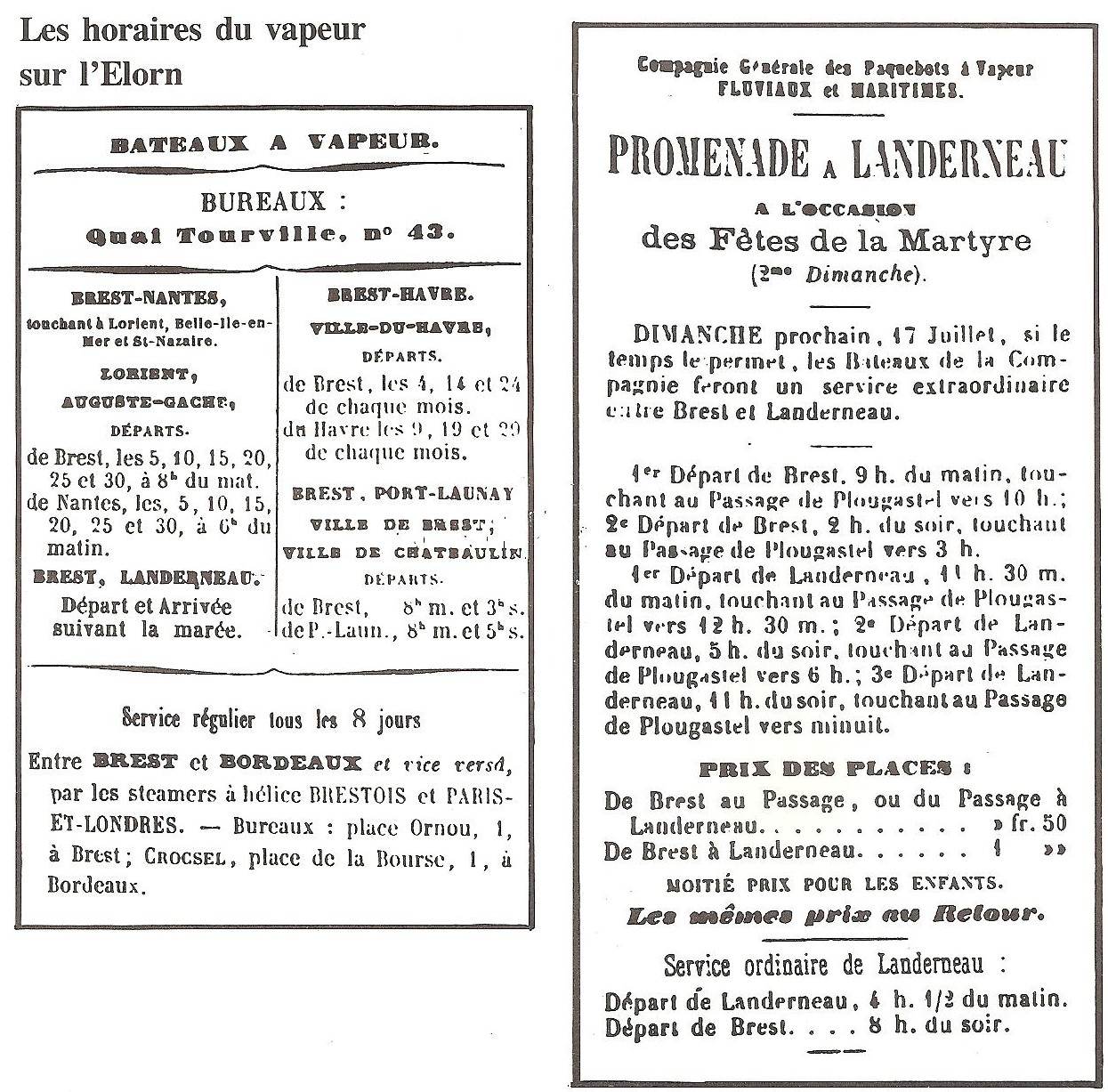
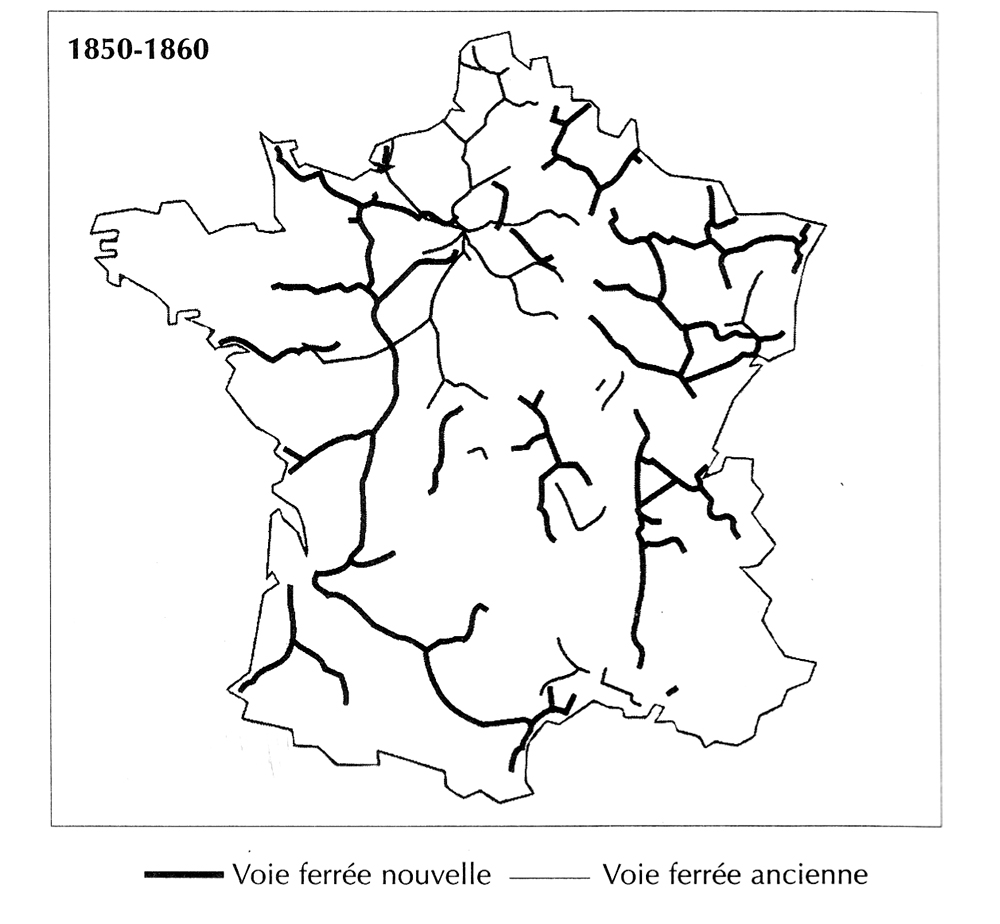
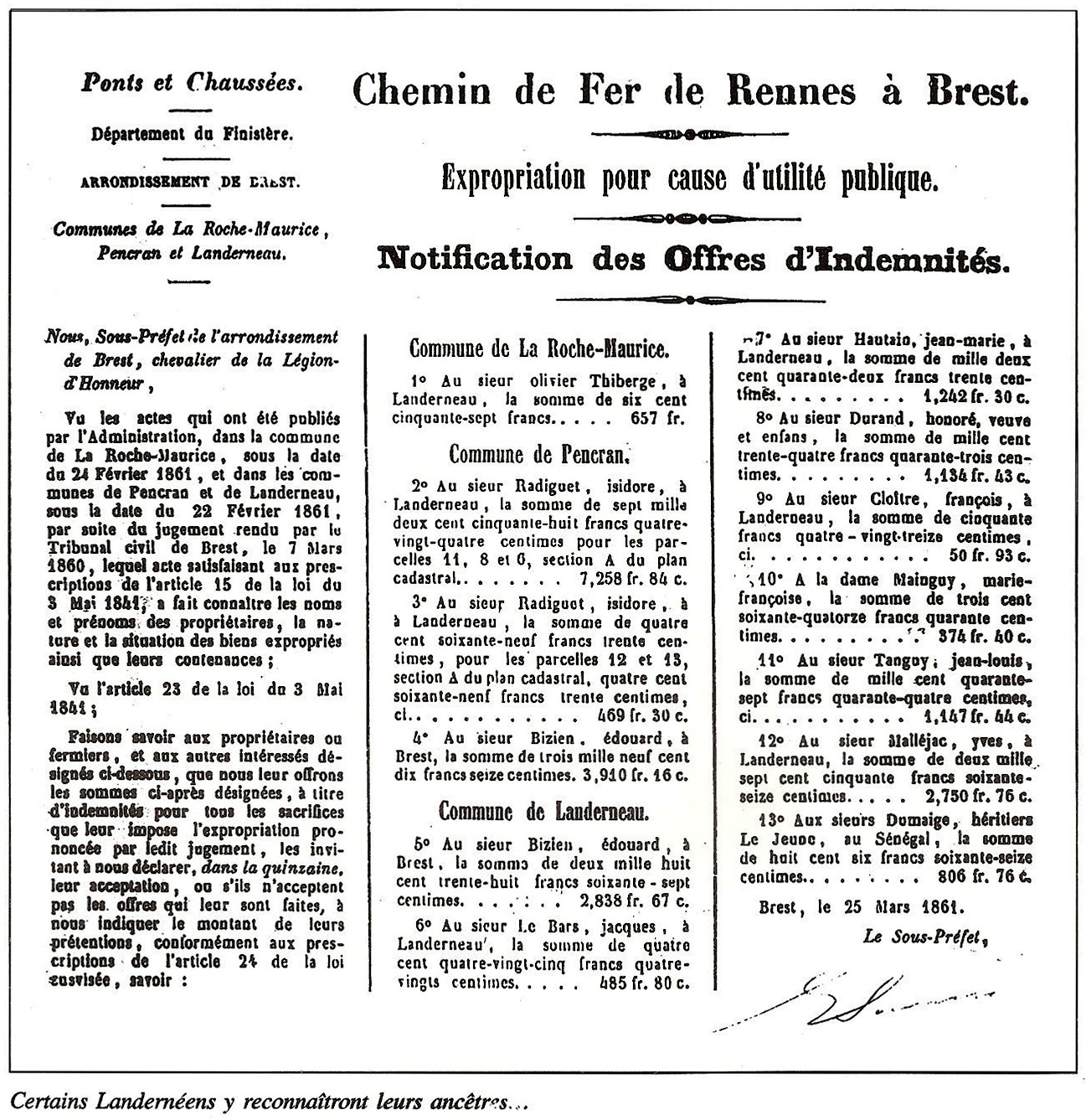
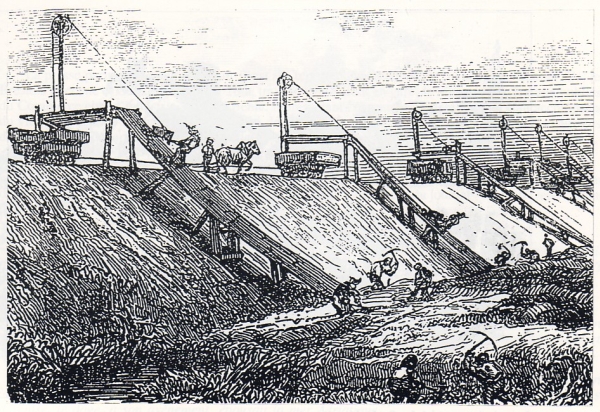
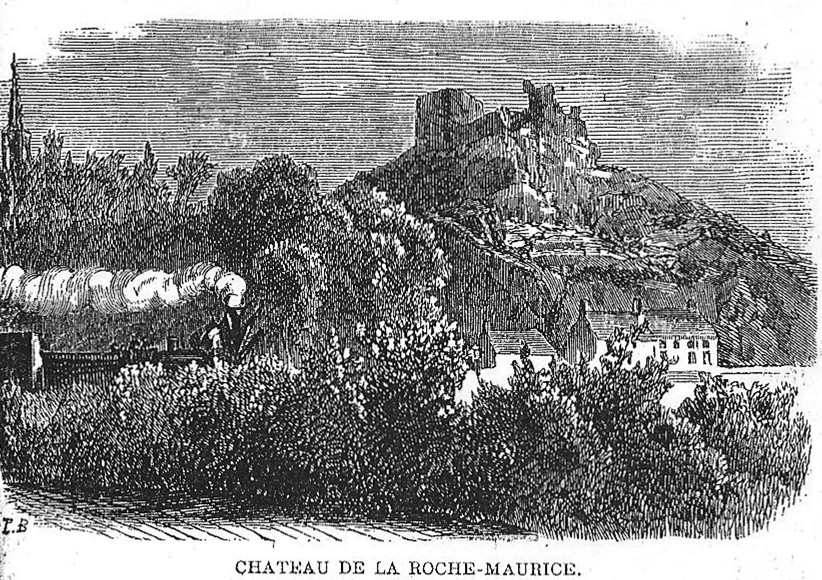

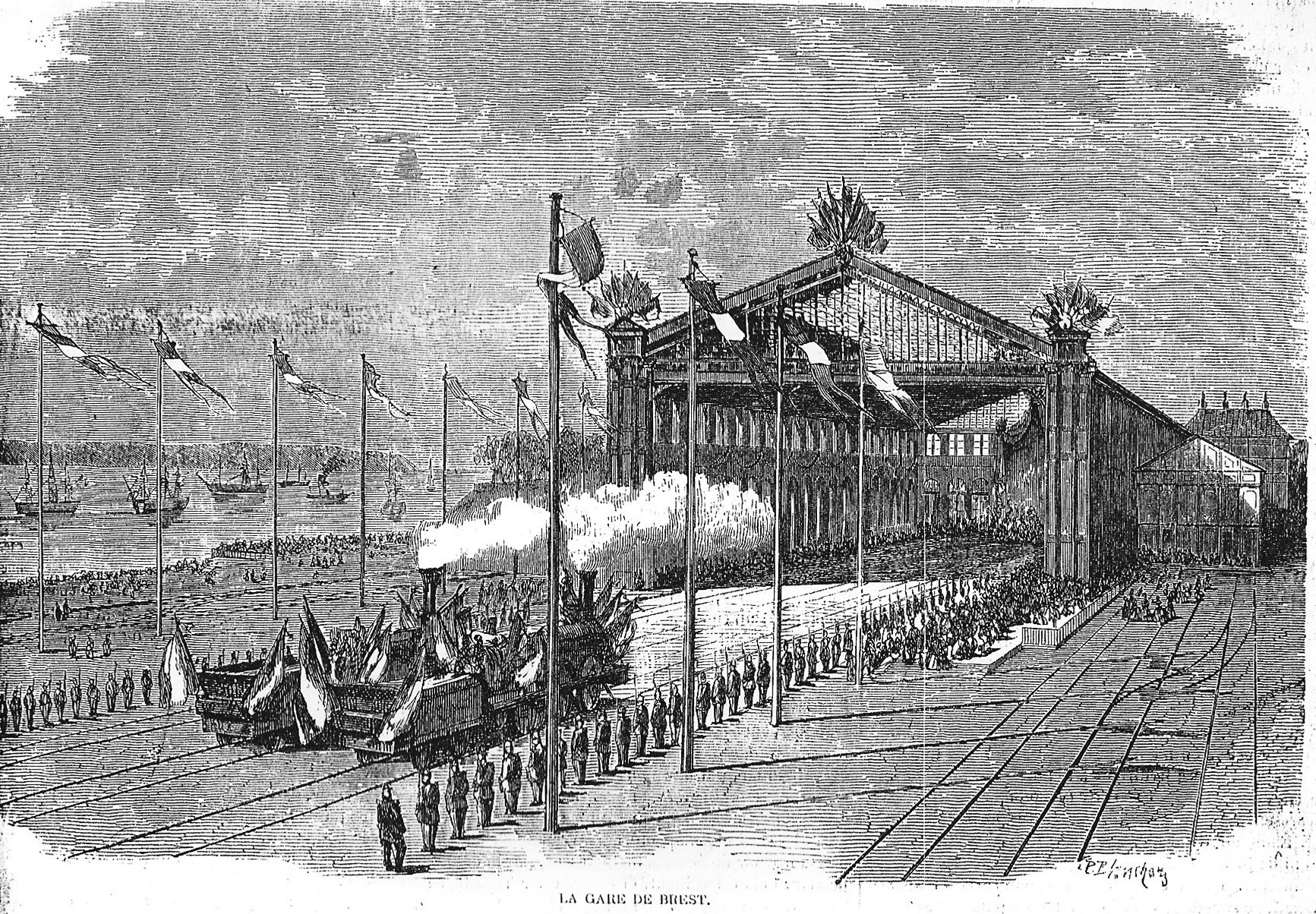
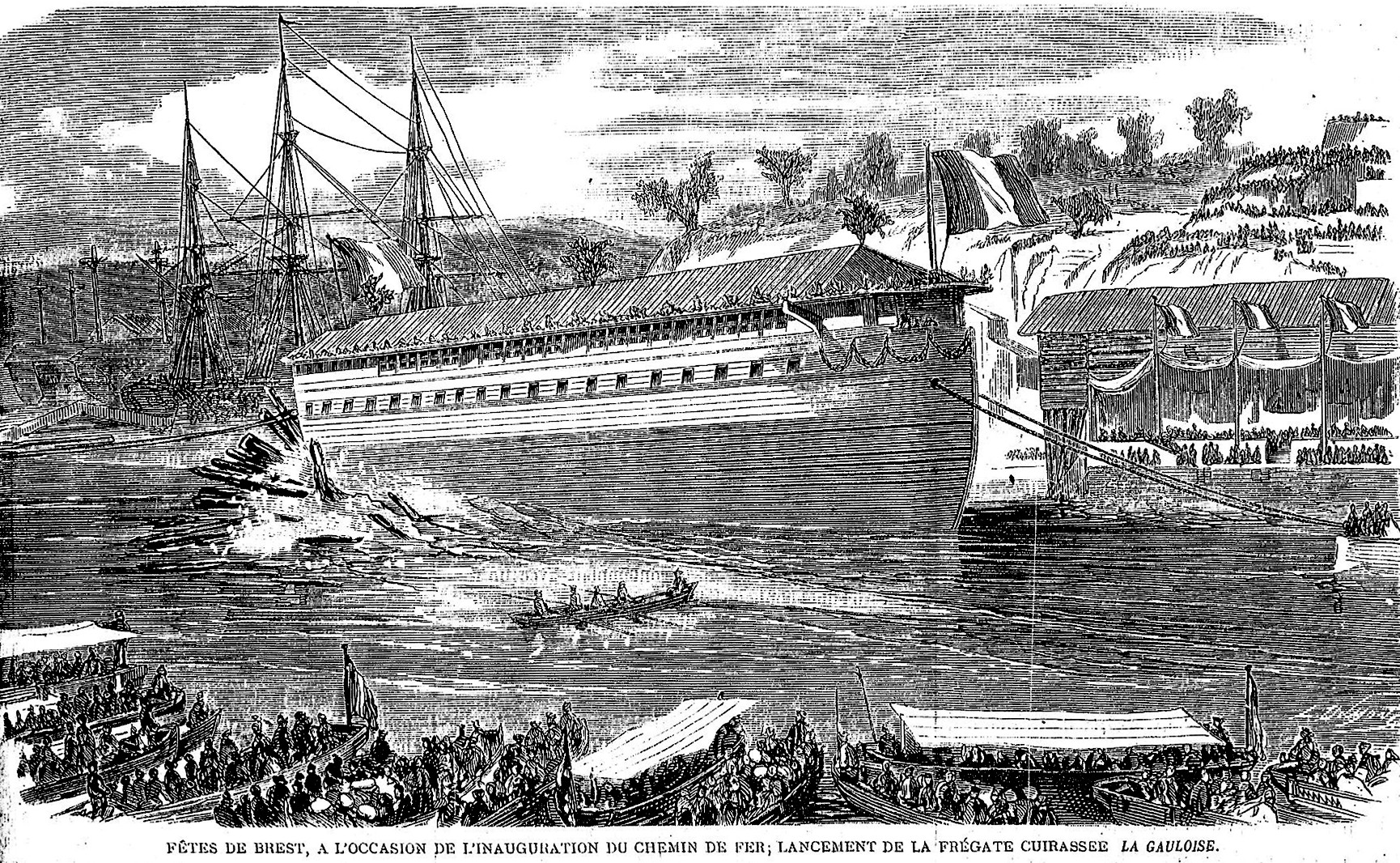
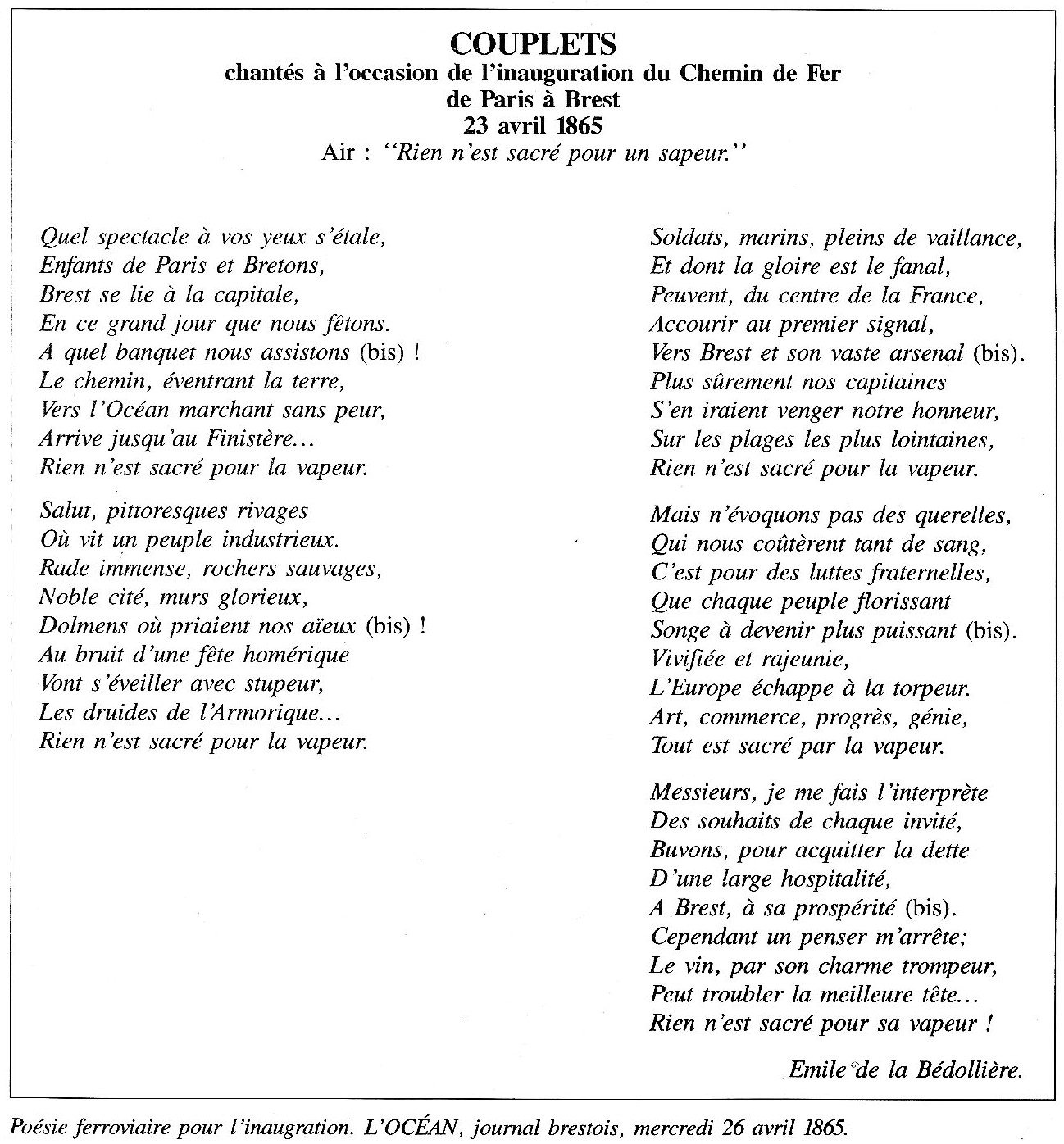

/image%2F0561035%2F20140324%2Fob_6b7b8e_003-vinci-dodecaedre-02.jpg)